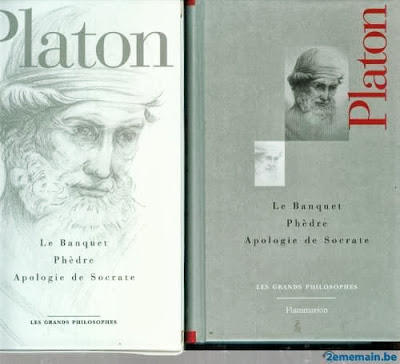 |
Lecture du Phèdre de PlatonAvertissement
Le lecteur pourra s'étonner d'entendre Platon parler de l'amour comme d'une relation entre deux hommes, ou même plus précisément entre un homme d'âge mur et un adolescent. Il faut savoir en effet que la Grèce antique, loin de condamner ce type de sentiment, le valorise. Certes les relations hétérosexuelles existent, mais elles renvoient à l'espace domestique privé, car elles sont directement subordonnées à la procréation. L'homosexualité au contraire est une version épurée de l'amour : totalement libérée des contraintes matérielles de la reproduction, elle exprime pleinement la spiritualité de l'homme.
Qui plus est, la relation entre un homme fait et un adolescent peut avoir une valeur pédagogique et citoyenne. Par les tendres soins de l'amant à l'aimé, l'aîné guide le plus jeune sur la voie de la vie, il l'introduit dans la cité, en fait un homme accompli et un citoyen. C'est dans la chaude amitié du maître et de son disciple que l'adolescent devient homme.
Plan de l'exposé
Introduction
Première partie : De l'amour
1 - Le discours de Lysias
Premier intermède
2 - Le premier discours de Socrate
Deuxième intermède
3 - Le deuxième discours de Socrate : la palinodie.
a - Éloge de la folie
b - La nature de l'âme
- immortalité de l'âme
- l'âme comme attelage ailé
- les différentes sortes d'âmes
Extension de l'analyse : les lignes de force de la philosophie platonicienne :
1) la partition du monde en monde sensible et monde intelligible
2) les Idées comme formes intelligibles
3) la connaissance comme réminiscence
4) un modèle de vie juste
c - Retour sur l'amour : L'amour donne des ailes
- L'amour est l'amour de la beauté
- L'ambivalence de l'amour
- La sublimation de l'amour
- La dialectique de l'amour
Deuxième partie : L'art de bien parler
1 - Faut- il savoir de quoi on parle pour bien parler ?
2 - Sans la connaissance, l'art oratoire n'est pas un art
Exemple du discours de Lysias.
Exemple des deux discours de Socrate.
3 - Dialectique et rhétorique.
4 - La parole et l'écriture.
5 - Fin de l'entretien
Conclusion
Introduction :de quoi parle-t-on ?
Dans la campagne athénienne, sous la chaleur de midi, accompagnés par le chant des cigales, deux hommes cheminent : Socrate et le jeune Phèdre. Pieds nus, ils marchent dans le cours de l'Ilissos pour se rafraîchir tout en devisant plaisamment. Bientôt l'ombre d'un platane, le murmure d'une source fraîche consacrée aux Muses, le parfum d'un gattilier en fleurs leur paraissent propice au repos, et ils s'y étendent : « Vois s'il te plaît comme le bon air qu'on a ici est agréable, et vraiment plaisant. C'est le chant mélodieux de l'été, qui répond au chœur des cigales. Mais la chose la plus exquise de toutes c'est l'herbe : la douceur naturelle de la pente, permet en s'y étendant, d'avoir la tête parfaitement à l'aise » (230c). Mais loin de céder à la tentation de la sieste, ils en profitent pour continuer et approfondir leur discussion.
Socrate plante le décor du discours avec tant de précision que les historiens ont tenté de localiser la scène. Cette mise en situation du discours est constante chez Platon : les Dialogues ne se lisent comme aucun autre traité de philosophie. La philosophie platonicienne est une philosophie incarnée. On est davantage dans le domaine de la parole que dans celui de l'écriture. Et la parole c'est toujours la parole de quelqu'un, de quelqu'un qui parle avec ses désirs et ses craintes, avec sa faiblesse ou son arrogance. Ce sont les parents du Lachès inquiets pour l'éducation de leurs enfants, ce sont les joyeux fêtards du Banquet qui décident après une nuit d'ivresse de rester sobres et de parler sérieusement de l'amour, ce sont plus tragiquement dans le Criton les amis de Socrate qui l'accompagnent vers la mort. Et tant d'autres…
Revenons donc à Socrate et Phèdre sous leur platane. De quoi parlent-ils donc ? Le sous-titre du dialogue en informe le lecteur : « Phèdre ou de la beauté ». Mais, à la lecture, les choses ne paraissent pas si simples. Ce qui apparaît au premier abord, c'est le manque d'unité du texte. Si en effet une première partie est consacrée à la beauté, ou plutôt à l'amour qui est amour du beau, la deuxième partie disserte sur l'art oratoire, et l'écriture. On ne voit pas bien ce qui articule ces deux parties ; à tel point que certains ont cru y voir soit la marque d'un manque de maîtrise d'un écrivain encore jeune, soit au contraire celle d'une forme de sénilité. Aimable divagation de la conversation qui de proche en proche, de dérive en dérive, conduit les interlocuteurs bien loin de leur point de départ ? Ce serait sans compter avec la forte charpente du texte qui n'est manifestement pas structuré au hasard.
Tout commence par la lecture par Phèdre d'un discours de Lysias qui soutient qu'il vaut mieux choisir pour amant celui qui ne vous aime pas que celui qui vous aime. (230e–234c)
À quoi Socrate oppose deux discours :
Le premier porte sur la forme : s'il voulait démontrer qu'il faut préférer celui qui ne vous aime pas à celui qui vous aime, Lysias aurait dû s'y prendre autrement, et Socrate, reprenant les positions de Lysias produit un autre discours. (237a–241d)
Le second porte sur le fond : prenant le contrepied de ce qui a été précédemment démontré, il développe sa propre vision de l'amour. (244a-257b)
Suit un long développement sur l'art du discours et la manière de bien parler (259a-274b), terminé par une comparaison entre la parole et l'écriture. (274b – 279c)
À la première lecture on peut donc penser que la question de l'amour et celle de la parole sont simplement juxtaposées, et selon que l'on privilégie l'un ou l'autre terme on pourra dire :
— Soit que le thème de l'amour est le thème premier du dialogue, celui de la parole n'étant que l'auxiliaire permettant de bien en parler.
— Soit que le thème est celui de la parole, le discours sur l'amour n'étant qu'un exemple permettant de définir le droit usage de la parole.
La lecture du dialogue nous montrera que le lien entre l'amour et le discours est bien plus qu'une simple juxtaposition. Nous aurons à découvrir en quoi ce lien est un lien organique qui unit les deux faces d'une seule et même démarche, celle qui conduit l'âme vers la contemplation des Idées : la dialectique.
I - De l'amour
Quand Phèdre rencontre Socrate sous les murailles d'Athènes, il sort de chez Lysias où il a entendu celui-ci prononcer un discours paradoxal sur l'amour : Lysias soutient en effet que pour un jeune homme il vaut mieux choisir pour amant quelqu'un qui ne l'aime pas que quelqu'un qui l'aime. Après s'être longtemps fait prier avec beaucoup de coquetterie pour parler de ce discours, Phèdre reconnait qu'il cache le texte sous son manteau, et accepte d'en faire la lecture à Socrate.
Le discours de Lysias230e-234c
Lysias annonce très clairement sa thèse dès le début de son discours : « J'estime que ce n'est pas une raison, parce que je ne suis pas amoureux de toi, pour que justement je ne doive pas avoir de succès dans ce que je t'ai demandé ». (230a) Notons au passage que Lysias personnalise sa position, c'est de son rapport à Phèdre qu'il est question. Ou plus précisément de son désir de voir Phèdre céder à ses avances et le prendre pour amant. L'argumentation de Lysias se situe clairement dans le cadre d'un projet de séduction. Ce qui peut peut-être engendrer quelques doutes sur son objectivité… Socrate insinuera d'ailleurs que le sujet du discours n'intéresse pas Lysias. « Sans doute son intérêt est-il ailleurs » ! (234a) Il est encore plus direct lorsque, dans l'histoire qu'il raconte dans son premier discours, il parle d'un amoureux « plus malin que les autres qui lui avait donné à croire qu'il ne l'aimait pas » (237b). L'allusion à Phèdre et Lysias est claire.
Suit une série d'arguments pour étayer cette position :
— Tout d'abord le fait que les bienfaits accordés par celui qui n'est pas amoureux n'ont aucune raison de disparaître avec le temps puisqu'ils sont accordés en toute raison et clarté, et non sous l'effet du désir qui, lui, risque toujours de s'éteindre. « Ce n'est pas poussés par la nécessité, mais de leur plein gré, après avoir délibéré le mieux possible sur leurs affaires personnelles, qu'ils sont bienfaisants » (230a).
— Celui qui aime est capable, pour plaire à son aimé, de faire n'importe quoi et de se rendre odieux aux autres. Mais quand il n'aimera plus, ou qu'il en aimera un autre, c'est vis-à-vis du premier qu'il deviendra odieux pour plaire au suivant.
— En réalité celui qui aime a perdu toute mesure et toute raison, il est malade : « Ils en conviennent eux-mêmes ; ils sont malades d'esprit plutôt qu'ils n'ont leur bon sens ; ils savent qu'ils ont perdu la tête mais ils sont, disent-ils, incapables de se dominer » (231d).
— Le choix pour le jeune homme est beaucoup plus restreint s'il doit choisir parmi ceux qui l'aiment, tandis qu'avec le plus grand nombre « tes chances sont beaucoup plus nombreuses d'y rencontrer celui qui mérite ton amitié » (231d).
— Celui qui aime perd le sens de la mesure, témoigne de manière exaltée et prétentieuse de la réussite de son entreprise amoureuse, se rend ridicule aux yeux des autres.
— Cette « publicité » indécente autour de son amour fait soupçonner que la relation avec son aimé est uniquement passionnelle et charnelle alors qu'elle devrait reposer sur une sage amitié. « Quand on les voit réunis ensemble on pense qu'ils sont alors réunis après avoir satisfait leur désir [….]. Au contraire ceux qui n'aiment pas, on ne tente même pas de les incriminer parce qu'ils sont réunis, car on sait bien que l'amitié ou un autre agrément sont des motifs de converser avec quelqu'un » (232b).
— Enfin celui qui n'est pas amoureux est à l'abri de la critique de ses amis car sa conduite n'a rien de critiquable « à ceux qui ne sont pas des amants aucun familier ne reproche d'avoir de mauvaises intentions» (234b).
CQFD est-on tenté de dire ! Comment Phèdre ne tomberait-il pas dans les bras de Lysias puisqu'il lui promet une amitié sans faille, constante et respectueuse, qui le rendra meilleur, le fera apprécier de tous, le mettra à l'abri de la jalousie, de l'aveuglement, de l'inconstance. Par la seule force de l'argumentation Lysias est parvenu à ce tour de force : dire à Phèdre : « Aime-moi parce que je ne t'aime pas. » La magie des mots a opéré une véritable transmutation du plomb en or : le non-désir, déclaré tel, devient plus fort que le désir.
1er intermède 234c–236a
Un tel discours ne manque pas de susciter l'ironie de Socrate qui s'amuse longuement à « taquiner » Phèdre sur son admiration béate pour Lysias, faisant mine de s'excuser de « s'attaquer ainsi à son amour ». Alors que Phèdre trouve le discours de Lysias « merveilleusement beau » (234c), complet : « de tous les éléments qui méritaient d'être traités, il n'en a omis aucun » (235b) au point qu'on ne peut en imaginer de plus plein, de plus grandiose, de plus grande valeur. Socrate au contraire considère que ce discours est pratiquement vide « Il dit les mêmes choses deux ou trois fois » (234a). Beaucoup d'autres orateurs ont tenu des discours infiniment plus complets sur le sujet ; et Socrate, parce qu'il les a entendus, « éprouve le sentiment d'être en état de dire beaucoup d'autres choses » (235c). Comme c'est souvent le cas, Socrate ne prétend pas tirer de lui-même son savoir. Il a souvent répété qu'il ne savait rien ; ce qu'il dit, il prétend l'avoir reçu d'autres plus savants : « Je me suis quelque part rempli à des sources étrangère à la façon d'une cruche » (235d). Ici il évoque Sapho ou Anacréon ; dans le Banquet c'est en reprenant les paroles de Diotime, la prêtresse de Mantinée, qu'il développe sa théorie de l'amour. Piqué au vif, Phèdre met Socrate au défi de prononcer un autre discours : « Considère que nous ne partirons pas d'ici avant que tu n'aies dit ce que tu prétends avoir dans le cœur. Nous sommes seuls, l'endroit est désert, je suis le plus fort et le plus jeune. En un mot : à bon entendeur, salut » (236c).
Après s'être fait longuement prier (« il avait grande envie de parler, mais il faisait des manières »), Socrate prend la parole. Mais ce premier discours il en a honte et le prononce en se voilant la tête : « Je vais parler la tête encapuchonnée pour arriver au plus vite au terme de mon discours et pour éviter qu'en te regardant, je ne perde, de honte, contenance » (236a).
Le premier discours de Socrate 236a–241d
Quand on prétend parler à propos d'une chose quelle qu'elle soit, il y a une règle élémentaire, c'est de commencer par la définir, ce que prend toujours soin de faire Socrate dans tous les dialogues. S'il faut démontrer que, pour un jeune homme, il vaut mieux accorder ses faveurs à celui qui ne l'aime pas plutôt qu'à celui qui l'aime, la première des choses à faire est de savoir ce que c'est qu'aimer, ce que c'est que l'amour : « quelle sorte de chose est l'amour et quels sont ses effets » (237c). N'ayant pas pris ce premier soin Lysias s'est contenté d'empiler les arguments le uns sur les autres sans aucune autre cohérence que celle de la juxtaposition.
C'est donc d'abord de définition qu'il faut s'occuper : qu'est ce qu'aimer ? À cette question Socrate répond : « L'amour est une espèce de désir » (237d). Mais le désir est double, il peut être le désir inné des plaisirs, que ce soit celui de la bonne chère qui s'appelle gourmandise, celui du vin qui s'appelle ivresse, ou celui des beaux corps qui s'appelle Éros. Ce type d'amour, « désir dépourvu de raison », « désir qui domine l'élan de l'opinion vers la rectitude » s'oppose à « l'aspiration au meilleur », « opinion rationnelle qui mène vers ce qu'il y a de meilleur » : la tempérance (237c-d).
L'amour étant ainsi défini, on peut alors poser la question qui préoccupe Lysias : quel avantage et quel dommage l'aimé peut-il attendre de celui qui est amoureux ?
En fait Socrate se limitera à parler des dommages, reprenant ainsi la plupart des arguments de Lysias, mais on notera d'ores et déjà deux différences majeures :
D'une part, grâce à la définition qu'il a donnée de la dualité de l'amour, il peut faire une première distinction : Il parle ici uniquement de l'amoureux gouverné par le désir du plaisir. Ce qui ouvre d'ores et déjà la porte à un tout autre discours, dès lors que l'on parlera non plus de l'amoureux dominé par la recherche du plaisir, mais de celui qui est guidé par l'amour du bien. (Ce sera l'objet du deuxième discours de Socrate.)
D'autre part cette définition lui permet également de donner une unité à son discours : les arguments qu'il reprend à Lysias ne sont plus simplement juxtaposés, ils sont les conséquences de l'égarement de celui qui se livre à la folie de son désir. C'est pourquoi l'amoureux qui est gouverné par le désir du plaisir nuit à celui qu'il aime : il veut faire de celui qu'il aime l'objet exclusif de son plaisir et veut donc le rabaisser pour mieux le dominer ; par jalousie, il ne supporte pas qu'il ait des relations avec d'autres ; il le contraint à une vie délicate et efféminée, son corps il le veut faible, mou et sans muscle ; il cherche à le priver de tous les attachements extérieurs, il le veut dépendant et soumis ; enfin au fil du temps il lui impose des relations avec un homme vieillissant et peu attirant qui finit par inspirer plus de dégoût que de désir. Simple objet de plaisir l'aimé est en fin de compte privé de l'essentiel : la recherche de la plus grande sagesse, la philosophie.
2ème intermède241d-243e
À Phèdre qui s'étonne à la fin de ce discours que Socrate n'ait abordé que la moitié du sujet – il n'a en effet pas parlé des bienfaits qu'apporte celui qui n'aime pas –, Socrate répond qu'il refuse d'aller plus avant et dit même son désir de partir. À cela deux raisons. En premier lieu, il suffirait pour assurer la deuxième partie du discours de prendre le contrepied de la première partie : « Tout ce qui a été vilipendé chez l'un correspond à l'inverse à autant de qualités chez l'autre. À quoi bon se lancer dans de longs développements » (241e). Mais surtout, et c'est la vraie raison, Socrate a honte du discours qu'il a tenu. On se souvient d'ailleurs qu'il avait tenu à parler « la tête encapuchonnée ». Il a honte parce que ce discours est « une stupidité et, sous un certain rapport, une impiété » (242d). Une stupidité parce que ce discours, comme celui de Lysias dont il reprend la thèse « impudente » va à l'encontre de la réalité. « Il n'est pas conforme à la réalité le discours qui déclare que, si on a un amoureux, il faut accorder de préférence ses faveurs à celui qui n'aime pas » (244a). L'amour peut être toute autre chose que ce sentiment malfaisant que Socrate et Lysias ont décrit. Il peut être l'amour d'un homme « de caractère noble et bienveillant qui soit ou qui ait déjà été l'amant de quelqu'un doué de pareilles qualités » (243c) et qui donne alors « le spectacle d'un amour digne d'un homme libre » (243c). C'est alors une véritable insulte vis-à-vis d'Éros, dieu de l'amour, que de l'avoir réduit à une si triste caricature.
D'abord tenté de partir, honteux du discours tenu, Socrate se ravise, sous l'insistance de Phèdre pour le retenir, mais surtout sur le conseil de son « démon », cette voix intérieure que Socrate entend monter en lui quand il s'agit de le retenir de faire une erreur. « Comme j'allais traverser la rivière, mon bon, le signal divin, celui dont j'ai l'habitude, s'est manifesté en moi » (242c).
Voilà donc Socrate décidé à reprendre la parole, mais cette fois à visage découvert : « Avant d'être puni pour avoir dit du mal d'Éros, je vais tâcher de lui offrir ma palinodie, la tête découverte et non point, comme je l'étais tout à l'heure, encapuchonné, parce que honteux » (243b). Une palinodie, c'est-à-dire un discours qui développe des thèses totalement opposées à celle du précédent.
Pour la petite histoire, on peut ajouter que, ce faisant, Socrate a repris l'avantage sur Lysias auprès de Phèdre. Ce discours a aussi pour but d'éloigner Phèdre de Lysias en lui montrant qu'il n'a rien à attendre de celui qui prétendrait le conquérir en lui disant qu'il ne l'aime pas, et de le rapprocher de Socrate. Voici maintenant Phèdre « tout près de toi, tout contre toi, toujours à tes côtés, chaque fois que tu le désires » (243e), comme il le dit à Socrate.
Le deuxième discours de Socrate :la palinodie243e-257b
C'est avec ce second discours que commence réellement l'exposé de la philosophie platonicienne.
Éloge de la folie244a-245c
Lysias condamnait celui qui aime parce qu'il voyait dans l'amour une sorte de maladie de l'âme, une folie. Il faisait au contraire l'éloge de l'homme raisonnable qui ne se laisse pas emporter par les délires de la passion amoureuse. Pour qui verrait dans la sagesse de Socrate l'effet de la froide raison, sa réponse peut paraître surprenante : la prise de parole de Socrate commence en effet par un éloge de la folie. Loin d'être toujours un mal la folie est le plus souvent « un don divin » qui nous apporte les plus grands bienfaits. Cette folie qui s'empare de l'homme sous l'emprise des dieux est en tous points supérieure au simple bon sens qui n'a jamais rien produit de grand : « Autant l'emporte en beauté – les Anciens en témoignent – la folie sur le bon sens, ce qui vient de dieu sur ce qui trouve son origine chez les hommes » (244e). De cette folie Socrate nous dit que nous ne devons pas la craindre et nous en défendre, mais au contraire considérer qu'elle nous apporte les plus grands des bienfaits. Il en énumère quatre formes :
C'est d'abord l'art de la prophétie (la mantique) : la folie s'apparente alors à la transe, à l'extase qui, chez la Pythie de Delphes par exemple, est expression de la parole divine. La religion grecque en effet faisait beaucoup appel à toutes sortes de médiations permettant de prévoir l'avenir. Mais parmi elles Socrate accorde une valeur supérieure à celles qui s'appuient sur la parole divine plus qu'à celles qui invoquent des signes matériels, comme le vol des oiseaux par exemple.
C'est ensuite l'art de ceux qui pratiquent la purification et l'initiation (la télestique). Ceux qui sont ainsi possédés de la parole divine ont aussi dans certains cas le pouvoir par les prières et les rituels de chasser les maladies dont certains sont affligés.
La troisième forme de possession est celle qui se manifeste dans la possession par les Muses et gouverne la création artistique (la poétique). Créer en effet n'est pas la simple application de techniques bien apprises. À celui qui voudrait apprendre à être poète ou musicien ou artiste en acquérant des savoir-faire il manquera toujours l'essentiel : l'inspiration, « la transe bacchique », « la folie dispensée par les Muses » (245a).
Et enfin – celle qui ici nous importe au plus haut point – celle qui s'empare de celui qui aime : l'érotique. « C'est pour leur plus grand bonheur que cette forme de folie leur est donnée par les dieux » (245b). Mais de ceci seuls les sages, ceux qui connaissent la nature de l'âme seront convaincus, c'est pourquoi Socrate nous impose un long détour par la philosophie qui engage la réflexion dans la complexité d'une cosmologie dont il n'est pas toujours aisé de débrouiller les fils.
La nature de l'âme245c -249d
L'immortalité de l'âme : l'exposé prend d'abord la forme d'une démonstration dont Socrate insiste sur la nécessité. L'âme est immortelle car elle est automotrice, elle se meut d'elle-même, elle est principe de mouvement, c'est-à-dire qu'elle est source, point de départ de son mouvement et de tout mouvement. En tant que principe elle est inengendrée, car si un principe était engendré par autre chose que lui-même il ne serait pas principe. Pour la même raison elle est incorruptible puisque c'est le principe qui est à l'origine de l'être et non l'inverse. « Or cet être ne peut ni être anéanti, ni venir à l'être ; autrement le ciel tout entier et tout ce qui est soumis à la génération s'effondreraient, s'arrêteraient et jamais ne retrouveraient une source de mouvement » (245e).
On ne peut comprendre ce que Platon dit ici que si on se détache de la conception cartésienne de l'âme qui domine la philosophie moderne. L'âme chez Descartes est synonyme de pensée ou d'esprit, elle est fonction de connaissance, toutes les autres fonctions étant renvoyées au corps, lui même assimilé à une machine. Le mouvement chez Descartes est mécanique, il ne nécessite l'intervention d'aucun principe moteur. « Le corps est une machine qui se remue de soi-même. » Le corps est matière et rien que matière, res extensa (chose étendue), et peut être étudié selon ses caractères géométriques ; c'est un automate naturel dont le mouvement s'explique par la seule disposition de ses organes, comme les rouages de l'horloge par exemple. De ce fait l'âme cartésienne, à l'inverse, est pure pensée : « L'âme par laquelle je suis ce que je suis est entièrement distincte du corps, et même qu'elle est plus aisée à connaître que lui, et qu'encore qu'il ne fût point, elle ne laisserait pas d'être tout ce qu'elle est ». Pour Platon au contraire, l'âme est principe d'animation. «L'âme s'est révélée à nous comme la cause, pour tous les êtres sans exception, de tout ce qu'il y a en eux, sans exception, de changement et de mouvement. »
Tout ce qui se meut est donc pourvu d'une âme, depuis les dieux jusqu'aux bêtes ; il y aura seulement lieu de faire des distinctions entre des espèces d'âme. C'est pourquoi le monde lui-même est doué d'une âme. « Tout ce qu'il y a au ciel sur la terre et dans la mer l'âme le mène au moyen de ces mouvements qui lui sont propres. » Les mouvements du ciel et des astres, le mouvement de l'univers dans son ensemble doivent être rapportés à la fonction motrice de l'âme du monde qui « mène de la sorte toute choses vers l'accroissement ou le décroissement, vers la décomposition ou la composition, ainsi que vers tous les mouvements qui font suite à ceux-là, échauffements et refroidissements, augmentations ou diminutions de poids, le dur et le mou, le blanc et le noir, l'âcre et le doux… ». S'ils déterminent ainsi des mouvements physiques, les mouvements de l'âme sont d'une autre espèce. Ils consistent à « vouloir, examiner, prendre soin, délibérer, opiner». Ce qui fait que pour l'âme la distinction entre mouvoir et être mu est dépourvue de sens. Le mouvement de l'âme est action.
L'âme comme attelage ailé : reste ensuite à définir la forme de l'âme, sa nature. Socrate n'a plus alors recours à la démonstration, mais au mythe : « Pour dire quelle sorte de chose c'est, il faudrait un exposé en tout point divin et fort long, mais dire de quoi elle a l'air, voila qui n'excède pas les possibilités humaines » (246a). Le mythe, on le sait, prend souvent chez Platon le relais de la démonstration quand il s'agit d'objets qui échappent à la connaissance humaine. Il a pour but de rendre sensible à l'imagination ce qui ne peut être connu par l'esprit, ce qui ne peut être l'objet d'une distinction rigoureuse.
L'image qui rend compte de la nature de l'âme, qu'elle soit divine ou humaine, c'et celle d'un attelage ailé, attelage composé d'un cocher et de deux chevaux. Pourvu d'ailes, l'attelage a le pouvoir d'entraîner vers le haut tout ce qui est pesant. Pour l'âme des dieux, pour laquelle cocher et chevaux sont de bonne race, l'attelage s'élève sans difficultés dans les hauteurs du ciel et s'y maintient, « il chemine dans les hauteurs et administre le monde entier » (246c), mais il n'en est pas de même pour l'homme et les autres vivants : « il y a mélange » (246b). L'un des chevaux est beau et bon, de bonne race, l'autre est tout le contraire, d'où la difficulté pour le cocher de mener son attelage.
Ce mythe reprend la tripartition de l'âme exposée par Platon à plusieurs reprises, en particulier dans la République. Le cocher représente la partie rationnelle de l'âme, (logistikon), c'est elle qui a la capacité de contempler l'intelligible. Le cheval de bonne nature représente le thumos, quelque chose comme le cœur, le courage mais aussi la colère et l'agressivité : c'est la faculté de s'enthousiasmer et de s'emporter au service du meilleur. Quand le cocher mène bien son attelage, il trouve en lui un allié essentiel, toujours prêt à aller de l'avant, à combattre pour son idéal, à défendre sa cause. Quant au mauvais cheval, il représente la troisième partie de l'âme, l'épithumia, le siège de l'appétit des passions et des désirs charnels. Rétif, toujours prêt à faire dévier l'attelage pour satisfaire ses désirs, il manque sans cesse de le faire chavirer. C'est sur cette tripartition de l'âme que Platon dans la République construit le modèle de la cité juste : les hommes se répartissent en trois classes selon que domine en eux l'une ou l'autre partie de l'âme : à ceux en qui domine la partie rationnelle, les philosophes, reviendra la tâche de gouverner la cité ; à ceux en qui domine le cœur, les gardiens ou soldats, reviendra celle de la défendre ; et enfin à ceux en qui domine l'appétit seront confiées les tâches matérielles permettant l'entretien de tous : les artisans et les agriculteurs. Platon explique que chaque partie de l'âme, et donc chaque classe d'hommes, a une vertu qui lui correspond : la tempérance pour l'âme désirante, le courage pour le cœur, la sagesse pour l'âme raisonnable. De l'harmonie de ces trois parties de l'âme résulte la justice ; de l'harmonie de ces trois classes résulte la justice dans la société.
Les différentes sortes d'âme. Donc tout ce qui vit, tout ce qui bouge a une âme. Mais il ne s'ensuit pas que toutes les âmes soient identiques. Du moindre animal aux dieux, Platon établit une continuité hiérarchique. La principale distinction est celle entre les vivants immortels (les dieux et les démons) et les vivants mortels (les hommes et les bêtes). Pour comprendre cette distinction, il est bon de revenir à nouveau au mythe. Les attelages grâce à leurs ailes « circulent dans la totalité du ciel » (246b), car « la nature a donné à l'aile le pouvoir d'entraîner vers le haut ce qui est pesant […]. L'aile est, d'une certaine manière, la réalité corporelle qui participe le plus au divin » (246d). Quand le cocher mène bien son attelage, les ailes maintiennent l'attelage dans les hauteurs, l'âme est parfaite et administre le monde entier, elle atteint la stabilité et la perfection du divin. L'âme des dieux est donc un vivant immortel uni pour toujours à un corps, mais un corps qui participe du divin. À la tête de ces vivants immortels, le dieu des dieux – Zeus – « qui conduisant son attelage ailé, s'avance en premier, ordonnant toute chose dans le détail et pourvoyant à tout » (246e). Il est suivi par l'armée des dieux et des démons, chacun à sa place et en bon ordre. On peut voir dans cette procession la représentation des corps célestes, les astres, dont les évolutions circulaires régulières et parfaites sont ce qui correspond le mieux à la description que Platon donne du vivant immortel. Ces âmes immortelles qui atteignent la voûte céleste ont vocation à aller au-delà et à « s'établir sur le dos du ciel » (247b). Ceci demande explication : Platon se représente le monde sensible, celui des corps visibles sous la forme d'une sphère, dont le ciel constitue la voûte interne. « Le dos du ciel » serait donc la face externe de cette voûte. Hors du monde sensible, elle est le lieu du monde intelligible. Une comparaison avec l'allégorie de la caverne du livre VII de la République permet de dire que l'intérieur de la sphère, le monde sensible est le monde de la caverne alors que ce qui est au dessus du ciel dans Phèdre est l'extérieur de la caverne et représente le monde intelligible. C'est bien en effet ce même monde que décrit Platon dans les deux cas : « un être sans couleur, sans figure, intangible » qui n'a donc aucune matérialité et ne peut donc être appréhendé que par l'intellect.
Tels sont bien les caractères de l'Idée telle qu'elle est définie dans la République. Là, l'âme contemple la véritable réalité. Quand elle reviendra ensuite à l'intérieur du ciel, elle s'en souviendra et rien ne sera plus pareil pour elle.
Mais à côté des attelages des dieux qui sont « équilibrés et faciles à conduire » (247b), il y en a d'autres qui « ont de la peine à avancer, car le cheval en qui il y a de la malignité rend l'équipage pesant, le tirant vers la terre, et alourdissant la main de celui des cochers qui n'a pas su bien le dresser » (247b). Cet attelage finit par perdre ses ailes et tomber sur terre où l'âme prend un corps, un corps pesant, un corps mortel. Exilée du monde céleste, elle constitue ce qu'il convient d'appeler un vivant mortel. Cette âme tombée du ciel n'a pu que peu ou pas du tout apercevoir la réalité vraie. À ceux-là ne reste en partage que l'opinion. Dans l'indescriptible désordre provoqué par les chevaux rétifs et les attelages mal contrôlés certains ont pu lever la tête et apercevoir fugitivement quelques réalités, d'autres n'y sont pas parvenus. Le type d'incarnation dépend du degré de vision de la réalité que l'âme est parvenue à atteindre. De là une hiérarchie entre neuf types d'hommes qui du philosophe au tyran en passant par l'homme politique, le médecin, le devin, le poète, l'agriculteur recouvre tous les degrés de la société humaine. (Notons qu'ici la partition de la société ne se fait pas en trois classes comme dans la République.)
Ainsi déchue, l'âme ne reviendra à son point de départ qu'au bout de dix mille ans ; cependant certaines âmes qui ont vécu dans la justice — « l'homme qui a aspiré loyalement au savoir ou qui a aimé les jeunes gens pour les faire aspirer au savoir » (248e) — peuvent se voir attribuer à nouveau des ailes au bout de trois cycles de mille ans. Les autres, au bout des dix mille ans passent en jugement, vont soit en prison s'ils se sont mal conduits, soit dans un lieu conforme à la vie juste qu'ils ont menée et au bout d'encore mille ans engagent une nouvelle vie, dans laquelle l'âme d'un homme peut s'implanter dans le corps d'un animal et vice versa.
De ce long développement on retiendra ce qui constitue les lignes de force de la philosophie platonicienne :
La partition du monde sensible et du monde intelligible :
Que ce soit l'opposition entre le monde des ombres dans la caverne et la réalité extérieure hors de la caverne dans la République, que ce soit l'opposition entre l'intérieur et l'extérieur du ciel dans le Phèdre, la philosophie platonicienne repose sur l'opposition entre un monde sensible qui n'est qu'apparence et dans lequel seule l'opinion est possible et un monde intelligible qui est la réalité dont la science est la connaissance vraie. Le monde sensible ne permet qu'une connaissance trompeuse, celle des sensations. Le monde intelligible est par contre connu par l'intellect seul, il est l'objet d'une connaissance vraie celle des Idées.
Les Idées comme « formes intelligibles »
a) Les Idées sont la réalité même, une réalité qui est d'ordre uniquement intellectuel. Il n'y a en elles aucune matérialité et leur connaissance ne se fait que par l'intellect seul, en dehors de toute sensation.
b) Les Idées sont le principe de l'intelligibilité : ce par quoi une connaissance est possible « en allant d'une pluralité de sensations vers l'unité qu'on embrasse au terme d'un raisonnement » (249b). L'idée est ce qui permet de mettre de l'ordre dans le chaos des impressions sensibles en les rapportant à l'unité d'une forme commune. La perception elle-même n'est possible que parce que nous y apercevons la forme.
c) Les Idées sont ce à quoi s'adresse toute connaissance. La connaissance est connaissance des formes pures. Toute connaissance cherche à s'éloigner du cas particulier pour aller vers l'essence. Ainsi les dialogues de Platon ne parlent pas des choses belles mais de La Beauté, des actes courageux mais du Courage, des actions vertueuses mais de la Vertu, et ainsi de suite. « Il faut en effet que l'homme arrive à saisir ce qu'on appelle « forme intelligible », en allant d'une pluralité de sensations vers l'unité qu'on embrasse au terme d'un raisonnement » (249b).
d) Les Idées sont le modèle de toute chose. Elles sont « le paradigme » de toute réalité sensible. Platon passe du plan de la connaissance au plan de l'Être. Les idées ont non seulement une fonction épistémologique mais une réalité ontologique. Les Idées sont le fondement de l'Être et l'Être lui-même. Il y a plus de réalité dans l'Idée que dans la chose parce que l'Idée est le modèle de la chose, la chose n'est qu'une mauvaise copie de l'Idée (par exemple un objet beau n'est qu'une représentation approximative de la Beauté). Là où la chose perçue est confuse, changeante, multiple, complexe, l'Idée, est claire, immuable, une, simple.
La connaissance comme réminiscence
Si l'âme n'avait pas dans une vie antérieure contemplé les Idées, jamais aucune connaissance ne serait possible. La connaissance est mémoire : « Il s'agit d'une réminiscence des réalités jadis contemplées par notre âme, quand elle accompagnait le dieu dans son périple […], qu'elle levait la tête pour contempler ce qui est réellement » (249c).
Ce thème de la réminiscence est un thème constant chez Platon. On le retrouve par exemple clairement explicité dans le Phédon : « L'instruction n'étant pour nous rien d'autre que remémoration, il est forcé, je pense, que nous ayons appris dans un temps antérieur les choses dont maintenant nous nous ressouvenons. Or, c'est ce qui est impossible, à moins que notre âme ne soit quelque part, avant de naître dans la forme humaine que voici. […] Un homme qu'on interroge, s'il est interrogé comme il faut, de lui-même s'exprime sur tous les sujets comme le demandent ceux-ci ; et pourtant, s'il n'en avait pas eu en lui-même connaissance et conception droite, il ne serait pas capable de le faire ; que, pour prendre ensuite un exemple, on le conduise à la considération des figures géométriques ou à quelque autre considération du même genre, on juge alors, avec toute la certitude possible qu'il en est bien ainsi. » Le Ménon en donne une illustration concrète : un jeune esclave sans instruction, interrogé par Socrate se révèle en mesure de retrouver par lui-même le théorème de Pythagore.
Traduit en des termes plus modernes et débarrassé de ses présupposés ontologiques, on pourrait dire que ce thème de la réminiscence se retrouve dans les théories intellectualistes pour lesquelles les idées préexistent nécessairement à l'expérience et la rendent possible. Dans la polémique qui l'oppose aux Empiristes pour qui l'expérience et l'expérience seule est source de connaissance, Leibniz rétorque : « Rien n'est dans l'entendement qui n'ait auparavant été dans les sens si ce n'est l'entendement lui-même. » Cette célèbre formule montre bien que, sans la préexistence a priori des structures de l'entendement, aucune connaissance ne serait possible. L'idéalisme transcendantal kantien reprendra cette même idée : l'universalité et la nécessité des connaissances mathématiques interdisent de penser qu'elles dérivent de la seule expérience, elles exigent la mise en œuvre des formes a priori de l'entendement qui seules permettent la synthèse des impressions sensibles.
Un modèle de vie juste
Plus l'âme a pu contempler les Idées et plus dans ce monde d'exil qu'est le monde terrestre elle parvient à les retrouver, plus elle connaît l'essentiel et plus sa vie est juste et vraie. Tel est le philosophe. Il faut à partir des choses d'ici-bas, se souvenir des réalités contemplées dans un autre monde et tenter de les reconnaître dans leurs mauvaises copies. « Mais ce n'est chose facile pour aucune âme » (250a). Celui qui parvient à « apercevoir quelque chose qui ressemble aux choses de là-bas » éprouve un double déséquilibre : d'une part « ces âmes sont projetées hors d'elle-mêmes et elles ne se possèdent plus » (250a), éblouies par la lumière qui les saisit, comme le prisonnier qui sort de la caverne, ces âmes sont comme aveuglées ; et d'autre part parlant de lumière dans un monde d'ombres, parlant de perfection dans un monde imparfait, il est nécessairement mal reçu par ses compagnons : « Comme il s'est détaché de ce à quoi tiennent les hommes et qu'il s'attache à ce qui est divin, la foule le prend à partie disant qu'il a perdu la tête, alors qu'il est possédé par un dieu » (249d). Là encore le parallèle avec l'allégorie de la caverne est clair : lorsque le prisonnier, après être sorti dans le monde extérieur, revient dans la caverne il est hué et ridiculisé par ses compagnons[15]. Allusion évidente au destin de Socrate que les Athéniens condamneront à mort.
Retour sur l'amour : L'amour donne des ailes 249d – 257d
L'amour est l'amour de la Beauté
Mais Socrate ne perd pas de vue ce qui fait l'objet de son discours : montrer, contre Lysias, que l'amour peut conduire au meilleur. Le long détour qui porte sur l'âme et son rapport au monde intelligible n'est pas une digression. C'est lui qui va permettre de montrer que l'amour, au même titre que l'art divinatoire, l'art de la purification et l'art poétique, est une forme de folie, la folie qui s'empare de l'âme quand elle est possédée par les dieux. Socrate place d'emblée l'amour dans la dimension du sacré. L'amour est mystère et révélation, il est de l'ordre de l'initiation, une initiation qui, on va le voir, demande une mutation de tout l'être.
Le véritable amour est l'émotion qui s'empare de celui qui, à travers un beau visage ou un beau corps, entrevoit l'idée même de la beauté, et n'a de cesse de s'en approcher au plus près. Là encore c'est la réminiscence qui est la clé de cette explication. L'Idée de la Beauté que l'âme a contemplée dans toute sa splendeur et son rayonnement dans une autre vie se révèle soudain à nos yeux. La Beauté a ce privilège en effet de pouvoir être aperçue par les yeux du corps, alors que la pensée elle ne peut être perçue par la vue : « Seule la beauté a reçu pour lot le pouvoir d'être ce qui se manifeste avec le plus d'éclat et suscite le plus d'amour » (250d). Avec l'amour du beau s'ouvre donc à l'âme une voie d'accès au monde intelligible qui se distingue de la voie de la connaissance. La marche réglée vers l'Idée qui consiste toujours à s'élever plus haut depuis le monde physique jusqu'aux idées, aux essences, et à la contemplation du Bien, n'est pas seulement une aventure intellectuelle, elle se double d'une expérience affective qui opère une mutation de tout l'être. Cette expérience qui est celle de l'amour doit nous révéler cet autre monde qui constitue le propre du discours philosophique. L'amour est connaissance. Cette façon de poser le problème montre à quel point la philosophie platonicienne, toute orientée vers le monde intelligible n'a cependant rien de froid de purement intellectuel. Elle est passion, ardeur, amour, désir passionné du Beau du Bien et du Vrai.
L'ambivalence de l'amour
Mais le chemin est rude et la voie est étroite. Socrate reprend la métaphore de l'aile pour expliquer les affres que traverse celui qui aime : « […] lorsque par ses yeux il a reçu les effluves de la beauté, alors il s'échauffe et son plumage s'en trouve vivifié ; et cet échauffement fait fondre la matière dure qui, depuis longtemps, bouchait l'orifice d'où sortent les ailes, les empêchant de pousser » (251b). L'amour ouvre les yeux, détourne le regard des choses d'ici-bas vers les choses d'en-haut. Comparable à l'enfant qui fait ses dents, l'âme « fait ses ailes », et elle est « en ébullition, elle est irritée, chatouillée pendant que ses ailes poussent» (251c). Possédée par le désir, l'âme est alors tiraillée entre deux états contradictoires. Vivifiée et réchauffée par la vue de l'aimé, elle se flétrit et ses plumes se dessèchent dès qu'elle est seule. « Le mélange de ces deux sentiments la tourmente, elle enrage de se trouver démunie devant cet état qui la déroute. Et prise de folie, elle ne peut ni dormir la nuit ni rester en place le jour, mais, sous l'impulsion du désir, elle court là où se figure-t-elle, elle pourra voir celui qui possède la beauté. Quand elle l'a aperçu […] elle dégage les issues naguère obstruées » (251e).
Cette ambiguïté de l'amour fait qu'il est tout sauf tranquille. Le Banquet explicite cette fièvre amoureuse qui ne laisse jamais en repos. « Fils d'Expédient et de Pauvreté, toujours il est pauvre et il s'en faut de beaucoup qu'il soit délicat et beau comme la plupart des gens l'imaginent ; mais bien plutôt il est rude, malpropre ; un va-nu-pieds qui n'a point de domicile, toujours couchant à même la terre et sans couvertures, dormant à la belle étoile sur le pas des portes et dans la rue ; tout cela parce qu'ayant la nature de sa mère, il fait ménage avec l'indigence ! Mais en revanche, conformément à la nature de son père, il guette embusqué les choses qui sont belles et celles qui sont bonnes, car il est vaillant, aventureux, tendant toutes ses forces ; chasseur habile, ourdissant sans cesse quelque ruse ; curieux de pensées et riche d'idées expédientes, passant toute sa vie à philosopher. […] De plus sa nature n'est ni d'un immortel, ni d'un mortel. […] Ainsi, ni jamais Amour n'est indigent, ni jamais il est riche[16]. » Cette ambivalence est dans la nature même de l'amour, car l'amour expliquera encore Diotime dans le Banquet est un démon. C'est-à-dire un être hybride qui n'est ni dieu ni homme. Il est le trait d'union entre les hommes et les dieux, il est celui qui conduit le mortel à l'immortalité, la révélation de l'absolu et du divin. L'amour n'est pas un dieu mais un démon, il n'est pas la béatitude de la contemplation divine par une âme libérée de tout tourment, il n'en est que le désir ; c'est pourquoi comme tout désir il est fièvre, attente, ou même douleur.
Portée par la pousse irrésistible de ses ailes, l'âme s'élève vers la Beauté, percevant dans celui qu'elle aime l'image du dieu dont elle suivait autrefois le cortège. L'harmonie entre amant et aimé se constitue par cette reconnaissance, les amants cherchant dans leur bien-aimé les qualités de leur dieu, et quand « ils en sont épris, ils font tout pour qu'il soit conforme à ce modèle » (252b). Ainsi en honorant son aimé c'est en fait son dieu qu'il honore.
La sublimation de l'amour
Pour expliquer comment se fait ce difficile cheminement qui conduit l'âme vers le monde intelligible, Socrate fait à nouveau appel au mythe de l'attelage.
L'attelage, rappelons-le, est composé d'un cocher et de deux chevaux. L'un est docile à la parole du cocher, « il aime la sagesse et la pudeur et est attaché à l'opinion vraie » (253d). L'autre au contraire « a le goût de la vantardise et de la démesure » (254e) ; il est rétif, sourd aux ordres du cocher. C'est ce dernier qui, lorsque le cocher est touché par les aiguillons de l'amour, l'entraîne sans pudeur vers l'aimé « s'élance d'un bond violent, donnant toutes les peines du monde à son compagnon d'attelage et à son cocher et il les contraint à se porter vers le garçon » (254a). Tel est le comportement de l'âme faible, celle qui a perdu de vue depuis longtemps le monde intelligible, et se livre sans vergogne aux désirs les plus bas. « S'abandonnant au plaisir, il se met en devoir, à la façon d'une bête à quatre pattes, de saillir, d'éjaculer, et se laissant aller à la démesure, il ne craint ni ne rougit de poursuivre un plaisir contre nature » (250e). Tel est le portrait de l'homme qui s'abandonne à une sexualité déréglée, tel est aussi l'argument qui permettra à Platon de condamner l'homosexualité lorsqu'elle n'est qu'assouvissement du désir sexuel entre deux hommes.
Mais, si le cocher se souvient de la beauté telle qu'il l'entrevoit dans le beau jeune homme, alors il cabre son attelage et châtie le mauvais cheval qui se rebelle. La lutte est violente, l'issue incertaine ; mais si le cocher est tenace, s'il parvient à dompter le mauvais cheval : « L'âme de l'amoureux est dès lors remplie de réserve autant que de crainte lorsqu'elle suit le garçon » (255a). Le jeune homme lui-même, conquis par l'admiration sincère que lui voue alors son amoureux, « se prend naturellement d'amitié pour celui qui est à sa dévotion » (255a), et il comprend que « la part d'affection que tous les autres lui dispensent n'est rien si on la compare à celle que procure l'ami possédé par un dieu » (255b). Entre eux se noue une relation faite d'admiration et d'estime mutuelle, de tendresse et de proximité physique, qui fait à son tour pousser les plumes du jeune homme. Celui-ci tout ému, encore aveuglé, ne comprend pas ce qui lui arrive, il éprouve à son tour du désir pour son amant : il désire « voir, toucher, aimer et partager la même couche » (255e), et « chaque fois qu'ils sont étendus côte à côte il est prêt pour sa part à ne pas refuser ses faveurs à l'amoureux » (256a). Le jeune Alcibiade, amoureux de Socrate, en est une illustration. Il raconte dans le Banquet comment il a tenté de tendre un guet-apens à Socrate pour le séduire, comment plein de désir il a passé une nuit à ses côtés et cependant dit-il, au matin « quand je me levais, il n'y avait rien de plus extraordinaire que si j'avais passé la nuit près de mon père ou d'un frère plus âgé[18] ». Socrate pourtant n'est pas insensible à la beauté d'Alcibiade mais ce qu'il lui propose c'est d'échanger beauté contre beauté : « Tu as dû voir au-dedans de moi une inimaginable beauté qui l'emporte infiniment sur les grâces de tes formes. » Cette beauté intérieure qu'offre Socrate c'est la vertu grâce à laquelle Alcibiade deviendra meilleur.
Le rôle de l'amant est alors d'orienter l'amitié et le désir de l'aimé non vers lui-même mais sur ce qui est le but du véritable amour : le Beau et le Bien. Ce qui se noue entre l'amant et l'aimé, comme entre le maître et l'élève, est tout le contraire d'une séduction ou d'une captation. Les émois d'une jeune âme qui s'éveille au savoir, le maître ne doit pas les capter à son profit pour satisfaire son propre désir mais la conduire progressivement vers les plus hautes pensées. Cet amour sublimé, délivré du désir physique est alors communion intellectuelle dans la contemplation des idées. Ceux qui sont parvenus à ce degré mèneront une existence harmonieuse bienheureuse et vertueuse. « Ils sont maîtres d'eux-mêmes et réglés dans leur conduite », ils ont « réduit en esclavage ce qui fait naître le vice dans l'âme et ont libéré ce qui produit la vertu » (256b). Leur âme pourvue d'ailes les conduira au monde des Idées. Si par contre ils n'ont pas réussi à se libérer d'une vie grossière, tournée plus vers les honneurs et la satisfaction personnelle, car en eux le mauvais cheval a pris le contrôle de l'attelage, dépourvus d'ailes, ils ne parviendront pas à voler.
Il est difficile de dire si pour Platon, cette incapacité à s'élever tient à une faiblesse naturelle, en quelque sorte constitutionnelle, de l'âme, ou si elle est de sa responsabilité, parce qu'elle se serait laissé corrompre.
La dialectique de l'amour
Dans le Banquet Platon donne une vision plus systématique de cette progression de l'amour qu'il est utile de reprendre.
Le cheminement qui conduit l'âme du monde physique, monde de l'apparence et de l'opinion, vers le monde des Idées doit se faire selon une progression réglée :
Tout commence par l'amour d'un beau corps : c'est la forme première de l'amour qui prend naissance dans notre réalité physique vivante : la sexualité. Un beau corps fascine le regard, éveille le désir. Il est promesse de plaisir. Rien d'étonnant à ce qu'il produise chez les jeunes gens une passion exclusive « l'amour violent d'un seul ».
La seconde étape est l'amour de tous les beaux corps : l'amour ne s'adresse plus alors à un seul corps, mais à la beauté de la forme telle qu'on peut l'apercevoir dans tous les corps. La formule peut avoir quelque chose de paradoxal puisqu'il s'agit d'aller de la beauté d'un objet à celle de plusieurs. Mais « la beauté en tout corps est une et identique ». L'amour de la beauté physique sous toutes ses formes est un premier pas vers l'unité de l'idée. L'Idée est forme, essence, une et non multiple, c'est elle que nous retrouvons identique à elle-même à travers la multiplicité des objets concrets. L'amour des belles formes c'est déjà un amour dématérialisé, épuré, qui ne s'adresse plus à la réalité charnelle de l'être singulier, c'est l'amour de l‘esthète, ce n'est plus celui du jouisseur. Mais l'esthète est encore fasciné par la réalité physique de la beauté, il ne peut la percevoir que par le recours des sens. Son âme est encore infirme, elle n'est pas encore capable de l'abstraction nécessaire à la contemplation de la beauté en elle-même.
La troisième étape est l'amour des belles âmes : passer de l'amour des beaux corps à celui des belles âmes c'est refuser de se laisser prendre aux apparences. Un beau corps peut masquer la sottise et le vice. Inversement un corps médiocrement attirant peut cacher un homme admirable par sa bonté, sa sagesse et son intelligence. Ces qualités intérieures provoquent un rayonnement qui est plus attirant que celui de la seule perfection physique. Cette beauté il faut la chercher dans la beauté des actions : dans la sagesse et la tempérance, le respect de l'ordre et de la justice en toute chose. La belle âme c'est l'âme juste, l'âme en équilibre, tant dans sa vie propre — elle sait gouverner les passions par la raison — que dans la vie publique — elle sait reconnaître les lois qui permettent à la communauté de vivre dans la paix et la justice.
La quatrième étape, poursuivant la progression sur la voie de l'abstraction, est l'amour des sciences : avec cette nouvelle étape, on accède à une forme de plus en plus épurée de la beauté. Jusqu'à présent l'amour avait encore le support d'une personne. Si on était passé du corps à l'âme, c'est encore d'un homme qu'on était amoureux, mais cet amour avait éveillé l'amour de la sagesse, de la justice, de l'ordre raisonné, de l'harmonie. Il s'agit maintenant d'en connaître le principe. Il s'agit de passer de la beauté des actions morales et politiques à l'amour de la beauté de l'activité intellectuelle elle-même. Ne parle-t-on pas d'un beau raisonnement ? N'y a-t-il pas une jouissance intellectuelle propre dans la connaissance, plaisir de comprendre, de résoudre une difficulté, de construire une belle démonstration ? C'est là un plaisir qui n'a plus aucune réalité physique, c'est la jouissance d'une beauté toute formelle, qui engendre la même jouissance chez le chercheur et chez l'amoureux. Notons que le terme « science » n'a pas exactement pour Platon le sens qu'il a pour nous. La science n'a pas pour objet la réalité matérielle mais au contraire les véritables réalités, les Idées : Idées mathématiques d'abord ; astronomie, géométrie, arithmétique, ce sont des « disciplines éveilleuses » qui nous habituent à tourner notre esprit « vers les choses d'en-haut » ; puis les Idées en elles mêmes dont la science est la philosophie.
La cinquième étape enfin est l'amour de la Beauté en elle-même, Beauté dont on peut définir les caractères : elle est éternelle, elle n'est soumise ni à la génération ni à la corruption, elle est immuable, elle ne change pas, elle est totale, elle n'est pas belle ici et laide là, elle est absolue, elle ne dépend pas de la relativité d'un jugement, elle est une. Il n'y a qu'une seule idée de la Beauté, elle est immatérielle : elle n'a aucun corps.
Avec la contemplation de l'Idée de la Beauté, l'abstraction de la dialectique ascendante est achevée. S'il est vrai comme on l'a noté précédemment que seule l'idée de la Beauté a la particularité de s'entrevoir par les sens, elle ne peut véritablement comme toute Idée être contemplée que par les yeux de l'esprit.
II - DE L'ART DE PARLER 257b – 279c
Nous voici donc en présence de trois discours différents (dont l'un, celui de Lysias, est écrit). Nous voici surtout en présence de deux discours radicalement opposés tenus successivement par le même homme : Socrate. La situation a de quoi surprendre. Comment peut-on ainsi dire tout et son contraire ? Face à cette situation il est légitime de se demander ce qui fait qu'un discours va sembler plus convaincant qu'un autre. Dans tous les cas, il ne s'agit que de mots et de rien d'autre. Quel est donc ce pouvoir des mots de produire l'adhésion de celui qui les écoute ? Quel est cet art de parler qui rend l'orateur convaincant ? Telle est la question que Phèdre, pris à la croisée des discours de Lysias et de Socrate, ne peut pas manquer de se poser. Tel va être désormais l'objet du débat avec Socrate.
Faut-il savoir de quoi on parle pour bien parler ?257b-260e
Après avoir entendu Socrate, Phèdre est tout prêt à se détacher du discours de Lysias et il reprend à son compte l'accusation de « logographe » porté contre lui. Logographe, c'est-à-dire faiseur de discours et plus précisément de discours écrits. À quoi Socrate répond « qu'il n'y a en soi rien de laid à écrire des discours » (258d). Ce qui est laid c'est seulement « de parler et d'écrire d'une façon qui n'est pas belle c'est-à-dire vilainement et mal » (258d).
Reste donc à établir ce que c'est que bien ou mal parler, ou bien ou mal écrire, et comme rien ne presse, qu'il fait chaud, et que les cigales chantent, les deux hommes ont tout le temps de se consacrer à cette question. D'autant plus, ajoute Socrate, qu'un mythe raconte que les cigales sont héritières d'une sorte d'hommes qui à la naissance des Muses se mirent à chanter tant et si bien qu'ils en oublièrent de manger et de boire, et ainsi moururent de faim. Les cigales en sont les héritières, et comme eux elles peuvent chanter sans se nourrir jusqu'au terme de leur vie. Ce terme venu, elles ont le privilège de se rendre auprès des Muses pour leur signaler les hommes qui ici-bas les ont honorées. Rendons donc hommage à Calliope et Ourania, les Muses « qui s'occupent du ciel et des discours » (259d), en continuant à philosopher, et ainsi peut être les cigales sauront-elles leur dire que nous leur rendons hommage.
Encouragés par cette heureuse perspective les deux hommes reprennent le débat. À la question posée : qu'est-ce que bien parler ?, Socrate avance une première réponse : la qualité du discours tient à la connaissance par l'orateur de ce dont il parle. C'est donc le contenu du discours qui fait sa qualité. Le bon orateur est celui qui sait de quoi il parle, et il parlera d'autant mieux qu'il maîtrisera parfaitement son sujet. « L'excellence et la beauté de ce qu'on va dire ne supposent-elles pas nécessairement que l'esprit de celui qui parle sache ce qui est vrai dans la question à traiter ? » (259e) Comme le disait Boileau, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement/ Et les mots pour le dire arrivent aisément. »
À quoi Phèdre rétorque que ce n'est pas ainsi que l'entendent les orateurs confirmés. Selon eux le bon orateur n'a nullement besoin de savoir ce qui est juste ou non, il lui suffit de savoir ce qui semble juste à ceux à qui il s'adresse. « Car c'est de l'opinion que procède la persuasion, certainement pas de la vérité » (260a).
Le cadre du débat est posé : d'un côté, le savoir et la vérité, de l'autre, l'opinion et l'apparence. Ce qui pourrait se formuler ainsi : « Faut-il savoir de quoi on parle pour bien parler ? »
Pédagogue comme toujours, Socrate raisonne d'abord sur un exemple. Suppose, dit-il à Phèdre, que je veuille te persuader de faire l'acquisition d'un cheval pour aller combattre l'ennemi. Mais ni toi ni moi ne savons ce qu'est un cheval. Par contre, nous croyons toi et moi qu'un cheval est un animal domestique à longues oreilles. Je pourrais alors très bien te persuader par un beau discours vantant les mérites de l'âne comme s'il s'agissait d'un cheval, de faire l'acquisition d'un âne. On imagine le succès de Phèdre arrivant au combat monté sur un âne !
Transposons maintenant à la question politique : si un orateur ignorant ce que sont le bien et le mal veut persuader des citoyens eux-mêmes ignorants, se fondant seulement sur l'opinion qu'ils en ont, il parviendra à un résultat tout aussi catastrophique.
Sans la connaissancede la vérité l'art oratoiren'est pas un art(260e-269d)
Face aux spécialistes de la communication que sont les partisans de l'art oratoire, Socrate soutient que l'art oratoire n'est pas un art s'il n'est pas fondé sur la connaissance de la vérité. Il est tout au plus une routine ou un savoir-faire. Cette distinction essentielle entre art et routine est développée plus avant dans le Gorgias, dans l'entretien avec Polos . Socrate y explique que derrière chaque art se glissent des contrefaçons qui prennent le masque des arts pour lesquelles elles veulent se faire passer : « Ainsi la cuisine s'est glissée sous la médecine dont elle a pris le masque ; elle fait comme si elle savait quels sont les aliments les meilleurs pour le corps[21]. » Ces contrefaçons visent l'agréable sans souci du meilleur. De même la rhétorique prenant le masque de la politique ne cherche pas à rendre les hommes meilleurs, ce qui devrait être le but de la politique : elle cherche seulement à les flatter, à leur dire ce qu'ils veulent entendre, elle est l'école de la démagogie.
Dépourvu de la connaissance du vrai, pire, disant pouvoir absolument s'en passer, le prétendu art oratoire qui s'accommode très bien de l'ignorance de ce dont on parle, n'est qu'une contrefaçon. Le pouvoir de persuader, tant dans les tribunaux que dans les assemblées, ne vise qu'à faire croire et non à faire savoir. La croyance est une impression, sensible à toutes les manipulations, alors que le savoir suppose l'acquisition raisonnée d'une connaissance. La rhétorique fait donc de la communication en elle-même une discipline autonome qui permet de parler avec un égal pouvoir de persuasion de n'importe quel objet indépendamment de la connaissance de cet objet. Gorgias en donne un exemple : « Je suis allé, souvent déjà, avec mon frère, avec d'autres médecins, visiter des malades qui ne consentaient ni à boire leur remède ni à se laisser saigner ou cautériser par le médecin. Et là où ce médecin était impuissant à le convaincre, moi je parvenais sans autre art que la rhétorique à les convaincre ».
Art de l'illusion l'art oratoire est en fin de compte l'art de la tromperie. Car pour faire prendre le vrai pour le faux il faut savoir où est le vrai et où est le faux. Or l'orateur se garde bien de le dire, il préfère le vraisemblable au vrai car il heurte moins la croyance de son interlocuteur : « Celui qui se propose de tromper quelqu'un d'autre, sans être lui même dupe de cette tromperie, doit savoir exactement à quoi s'en tenir sur ce à quoi ressemblent les réalités en question et sur ce dont elles diffèrent » (262a). Tout son savoir faire consistera alors sciemment à glisser de ce dont on parle à ce qui lui ressemble, de petites différences en petites différences, finissant en fin de compte par faire prendre l'ombre pour le réel.
Exemple du discours de Lysias
Le discours de Lysias en est un bon exemple. Il permet de montrer comment « un homme qui connaît le vrai peut, en faisant de la parole un jeu, égarer ses auditeurs » (262d).
Quelle est la faute de Lysias ?
Il y a deux types d'objets sur lesquels peuvent porter les discours : ceux sur lesquels il est facile de s'entendre, les choses matérielles par exemple, et ceux sur lesquels cela est beaucoup plus difficile, comme le juste ou le bon. Il va de soi que la tromperie est plus aisée dans le second cas. Il est nécessaire, quand on se met en devoir de convaincre, de déterminer d'abord duquel de ces deux types d'objets on va parler. L'amour, sur quoi porte le discours de Lysias, appartient manifestement au second type, celui des choses dont on dispute, et sur la définition desquelles il est urgent de se mettre d'accord sous peine de dire n'importe quoi. Or Lysias, à aucun moment, contrairement à ce qu'a fait Socrate, ne s'attarde sur la définition de l'amour. Il pose les conséquences avant les prémisses, il déduit ce qu'il veut démontrer des conséquences qu'il en tire : celui qui n'aime pas est meilleur que celui qui aime car celui qui aime se repent du bien qu'il a fait quand il n'est plus amoureux, « il ne part pas du début, mais de la fin. Il entreprend la traversée du discours en nageant sur le dos, à reculons » (264a). Ce raisonnement à l'envers, c'est très exactement la définition du sophisme.
Faute de cette définition, l'argumentation de Lysias n'est qu'un ramassis sans ordre d'arguments. Son discours n'est pas construit, sa composition n'a aucune nécessité, car il n'a aucun principe directeur. Un bon discours au contraire doit être « constitué à la façon d'un être vivant, qui possède un corps à qui il ne manque ni tête ni pieds, mais qui a un milieu et des extrémités, écrits de façon à convenir entre eux et à l'ensemble » (264c). Dans un organisme vivant comme dans un discours, c'est l'unité du tout qui détermine l'organisation des parties.
Exemple des deux discours de Socrate
Socrate en vient ensuite à l'examen de ses propres discours, dont on se souvient qu'ils étaient contradictoires « l'un affirmait qu'il fallait accorder ses faveurs à l'amoureux ; l'autre à celui qui n'aime pas » (265a). La contradiction entre les deux discours s'explique dès lors qu'on s'aperçoit que bien que soutenant tous les deux que l'amour est folie, les deux discours s'appuient sur deux visions différentes de la folie. Il y a en effet deux sortes de folie : « l'une qui est due à des maladies humaines, l'autre à une impulsion divine » (265a). C'est cette dualité qui a permis à Socrate, en passant d'un discours à l'autre, de passer « du blâme à l'éloge ». Dans le premier discours Socrate condamne l'amour parce qu'il rend fou celui qui aime, au sens où il le rend malade, lui fait perdre tout bon sens et toute raison, d'où le tableau pitoyable de l'amoureux qu'il reprend à Lysias. Dans le second discours au contraire la folie amoureuse n'est plus maladie mais au contraire possession divine. Plus encore que l'inspiration divinatoire, l'inspiration initiatique et l'inspiration poétique, la folie amoureuse est la forme supérieure de la folie divine.
Dialectique et rhétorique269d -274b
L'analyse des discours à laquelle vient de se livrer Socrate montre clairement qu'il est indispensable pour celui qui se met en situation de parler – et de convaincre par la parole – de maîtriser deux procédés essentiels. Le premier est celui du rassemblement « vers une forme unique, mener, grâce à une vue d'ensemble, les éléments disséminés de tous côtés » (265d). La définition du concept de ce dont on parle est la condition préalable à toute argumentation postérieure. C'est ainsi que la définition de l'amour (exacte ou inexacte, ce n'est pas encore là la question) a permis de donner au discours de Socrate une cohérence que n'avait pas celui de Lysias. Faute de cette définition tous les glissements de sens sont possibles et donc toutes les manipulations.
Le second procédé est celui de la division : « Elle consiste à l'inverse, à pouvoir découper par espèces suivant les articulations naturelles » (266a). C'est ainsi que la division des deux sens de la folie a permis d'expliquer l'opposition entre les deux discours de Socrate : « Nos deux discours ont considéré le dérangement de la raison en nous comme une espèce naturelle unique, même si l'un de ces discours a coupé un morceau du côté droit, alors que l'autre a coupé du côté gauche. Le premier ne s'est pas arrêté avant d'avoir trouvé en eux une sorte d'amour qu'il a appelé de gauche et qu'il a vilipendé tout à fait à juste titre ; l'autre discours, nous conduisant sur le côté droit de la folie, y a trouvé à son tour une espèce divine de l'amour » (265e–266a).
Ce n'est qu'à la condition de savoir raisonner, conduire sa pensée avec rigueur et méthode que l'on peut espérer bien penser et donc bien parler, car pour Socrate l'un demeure la condition de l'autre. Cet art du discours raisonné Socrate propose de le nommer dialectique : « Diviser selon les genres et ne point juger la même une nature qui est autre, ni une autre celle qui est la même, n'affirmerons nous pas que cela est du ressort de la dialectique ? » Cette notion, centrale chez Platon, désigne la constante mise en débat de la pensée avec elle-même que permet le dialogue. La pensée ne peut progresser vers son terme, la contemplation du Bien, que si elle s'interroge elle-même, si elle se critique elle-même. C'est en dévoilant et dépassant ses propres contradictions que la pensée progresse sur le chemin de la connaissance. En cela le dialogue est beaucoup plus qu'une forme littéraire, il est la mise en œuvre pratique de cette interrogation. Dans le va-et-vient entre les interlocuteurs, la pensée se précise, s'affirme, et progresse. Pour cela il faut un meneur de jeu qui, comme Socrate, sait à toutes les étapes de la démarche mettre en œuvre l'exigence de rigueur er de méthode sans laquelle on reste dans la confusion du débat d'opinion. « Celui qui sait interroger et répondre, comment l'appellerons-nous sinon dialecticien ? »
Mais il s'en faut de beaucoup que ces conditions soient celles que préconise la rhétorique, objecte Phèdre. Socrate feint la surprise : « Se pourrait-il qu'il y ait en dehors de ces deux-là (la division et le rassemblement), un procédé utile dont l'art nous permette l'acquisition ? » (266d). Phèdre se met alors en devoir d'énumérer ces procédés dont font usage les rhéteurs. Ces procédés portent tous sur l'ordre de l'exposition et non sur l'ordre de la pensée : ainsi, selon les rhéteurs Théodore, Evenos de Paros, Tisias, Gorgias, Hippias, Polos, Protagoras et bien d'autres, on a distingué le préambule, puis l'exposition, les témoignages à l'appui, les indices, les présomptions, la preuve, le supplément de preuve, et aussi la réfutation, le supplément de réfutation, l'insinuation, l'éloge indirect, les blâmes indirects, sans oublier la récapitulation.
Ces énumérations, ainsi que celles de leurs auteurs, montrent à quel point la rhétorique définie comme art oratoire avait droit de cité à Athènes. L'art de parler y était un art reconnu, codifié, qui avait ses spécialistes, lesquels se disaient en mesure, grâce à la force de leur discours « de faire paraître petites les grandes choses et grandes les petites » (267a), et de pouvoir de la même façon « mettre les foules en fureur, puis à l'inverse apaiser cette fureur par enchantement » (267c).
Ce pouvoir reconnu de la rhétorique coïncide à Athènes avec l'avènement de la démocratie où la question du bien-parler est devenue une question centrale. Les citoyens y deviennent de véritables acteurs de la vie politique siégeant dans les assemblées et les tribunaux. L'agora, la place publique, n'est plus seulement lieu de commerce mais lieu de parole et de pouvoir. Dans cette civilisation de la langue, le pouvoir n'appartient ni aux mieux nés, ni aux plus forts, ni aux plus sages, mais à ceux qui savent parler. Puisque ce sont les citoyens qui décident c'est eux qu'il faut persuader. Ce ne sont plus les armes qui sont les instruments du pouvoir mais les mots. D'où la prolifération des « spécialistes », qu'on les appelle sophistes ou rhéteurs, qui se font fort, moyennant finance, d'enseigner aux jeunes Athéniens l'art oratoire, art de persuader de tout et de n'importe quoi.
Il n'y a cependant là rien qui mérite le nom d'art, mais seulement des savoir-faire sans finalité, dit Socrate : un homme qui sait administrer des traitements à un malade, sans savoir ce qu'est sa maladie et si le remède lui convient, n'est pas un médecin ; un homme qui sait construire des tirades sans connaître l'art tragique n'est pas un tragédien ; un homme qui sait jouer d'un instrument sans connaître l'harmonie n'est pas un musicien. Ils n'ont que des « connaissances préliminaires » (269b). Pour Socrate, ce que les sophistes définissent comme la rhétorique n'en est que la condition préliminaire. La vraie rhétorique, pour Socrate, c'est la dialectique.
Si on ne veut pas en rester à la routine et au savoir-faire, on doit procéder à « l'analyse d'une nature », que ce soit celle du corps pour la médecine ou celle de l'âme pour la rhétorique. Là encore il faut procéder avec ordre et méthode, savoir si l'objet dont on parle est simple ou multiple, savoir ensuite quel effet il produit ou quel effet est produit sur lui ; on doit enfin établir des correspondances entre les différents types d'objets et les différents types d'actions qui agissent sur lui.
Appliquée à l'âme et aux discours qui peuvent agir sur elle, c'est-à-dire la persuader, il faut donc d'abord savoir quelle est la nature de l'âme, ce qui ne va pas, comme on l'a vu, sans s'interroger sur la nature de l'univers. Il faut ensuite savoir combien il y a de genres d'âmes, « il y en a tel ou tel nombre, de telle ou telle qualité ; par suite les hommes ont telle et telle personnalité » (271d). Il faut de même savoir combien il y a de genres de discours et quel type de discours est à même de persuader quel type d'âme. C'est donc tout à la fois des considérations d'ordre métaphysique, cosmologique et psychologique qu'il faut développer.
Mais ce n'est pas là « une mince affaire » (272b), la route est « longue et raboteuse » (272c). C'est pourquoi la plupart de ceux qui pratiquent l'art oratoire cherchent un chemin plus facile, « une route qui soit courte et unie » (272c). Ceux-là prétendent qu'il n'est pas nécessaire de connaître la vérité sur ce dont on parle pour bien en parler. Le vraisemblable suffit, et il est même souvent plus efficace de s'en tenir au vraisemblable. Dans les tribunaux par exemple « il y a même des cas où il faut éviter d'exposer les faits, s'ils ne sont pas vraisemblables, et s'en tenir à la vraisemblance » (272e).
Or le vraisemblable c'est « l'opinion du grand nombre » (273b), l'apparence du vrai. Le vraisemblable, c'est ce que croit l'opinion, parce que c'est ce qui choque le moins ses habitudes, ses routines de pensée. C'est la marque d'une pensée paresseuse qui ne veut rien remettre en question, une pensée qui s'appuie sur l'assentiment public plus que sur l'examen raisonné. S'en tenir à cette opinion, c'est chercher à plaire, donc à flatter, ce n'est pas chercher à savoir donc à éduquer. On sait en effet que la vérité est rarement dans le prolongement de l'opinion. La rechercher suppose une rupture avec les habitudes intellectuelles, une torsion sur soi comparable à celle que doit s'imposer le prisonnier qui sort de la caverne. Comme lui, l'homme sensé ne doit pas chercher à plaire à ses compagnons d'esclavage, il doit dire « ce qui plaît aux dieux » (273e). Ainsi acquérir l'art oratoire suppose de fournir d'immenses efforts, mais « pour peu qu'on accepte ces détours, on obtiendra des résultats merveilleux » (274a).
Connaître ce dont on parle, en parler avec ordre et méthode, telles sont les seules conditions d'un art oratoire digne de ce nom. Platon, comme Descartes en un autre temps, met en évidence que la seule règle de la pensée est la méthode, et que la méthode ne demande aucune règle compliquée, aucun artifice pédant. La méthode n'est rien d'autre que l'exigence de bon sens d'une pensée qui se développe avec rigueur, et cette exigence est partout et toujours la même. Socrate s'étonnait qu'hors du rassemblement et de la division il puisse y avoir d'autres règles utiles à la pensée, de même Descartes réduisait à quatre les règles pour bien conduire son esprit. Les complications rhétoriques, les gesticulations de tous ordres qu'enseignent les sophistes, n'ont d'autre effet que d'enfermer la pensée dans un carcan stérile, et de faciliter l'illusion. Ce soi-disant savoir renforce sans doute le pouvoir des « spécialistes » qui en profitent pour se faire payer plus cher, il ne sert pas la vérité.
La parole et l'écriture274b-278b
Reste un point à débattre, celui de la compatibilité entre ce discours, dont Socrate vient de définir les règles, et l'écriture. Le discours de Lysias en effet on s'en souvient était un discours écrit que Phèdre dissimulait sous son manteau et dont il a simplement fait la lecture. Le discours de vérité peut-il s'inscrire dans cette forme écrite, ou ne risque-t-il pas d'y perdre sa qualité essentielle : la dialectique ? « Convient-il ou ne convient-il pas d'écrire ? » (274b)
Encore une fois, Socrate entame le débat en racontant un mythe : le mythe de Theuth, divinité égyptienne à qui on attribue l'invention de l'écriture ainsi que du calcul, de la géométrie, et de jeux comme le tric-trac et les dés. Theuth s'en alla présenter ses découvertes à Thamous, roi d'Égypte. Quand il en vint à présenter l'écriture il vanta ses mérites en disant que, grâce à elle, les Égyptiens gagneraient « plus de science et plus mémoire » (274e). Mais tel n'est pas l'avis de Thamous, dans la bouche de qui Socrate met ses principaux griefs contre l'écriture :
— En premier lieu loin de faciliter la mémoire l'écriture favorisera l'oubli, car ce qui est écrit n'a plus besoin d'être mémorisé. La mémoire écrite est une mémoire morte, par laquelle la faculté de mémorisation, mémoire vivante indispensable à l'activité intellectuelle, dépérit. « Cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire » (275a). Theuth se trompe en croyant faciliter la mémoire, ce qu'il facilite c'est seulement la remémoration, c'est-à-dire la capacité à retrouver une information qui n'a pas été stockée dans l'esprit mais seulement sur du papier. (Et que ne dirait-on pas aujourd'hui des facilités que donne l'informatique en termes de stockage, classement et recherche !). Loin de faciliter la vie intellectuelle, cette capacité de stockage externe favorise un esprit paresseux, qui croit qu'il suffit d'ouvrir un livre ou de cliquer sur un ordinateur pour penser.
— Si l'écriture ne développe pas la mémoire, elle ne développe pas non plus la science. Là encore celui qui a accumulé beaucoup de choses écrites se trompe en imaginant être savant. Les savoirs qui sont emmagasinés dans sa bibliothèque sont eux aussi des savoirs morts : « Lors donc que, grâce à toi, ils auront entendu parler de beaucoup de choses, sans avoir reçu d'enseignement, ils sembleront avoir beaucoup de science, alors que dans la plupart des cas ils n'auront aucune science. […] Ils seront devenus des semblants de savants au lieu d'être des savants » (275b). Là encore, nous sommes dans le domaine de l'apparence et donc de l'illusion. À ce savoir écrit il manque l'essentiel : l'enseignement, c'est-à-dire la formation intellectuelle qui, par la médiation du maître, permet à l'élève de s'approprier un savoir, de le faire sien et donc ainsi de pouvoir l'utiliser. Le savoir des livres est simple érudition, il ne fait pas sens, il n'a aucun pouvoir de vérité.
— À cette charge de Thamous contre l'écriture, Socrate ajoute toute une série d'arguments : l'écriture ressemble à la peinture (c'est d'ailleurs le même verbe en grec qui signifie peindre et écrire). La peinture représente des êtres qui ont l'air vivants mais « qui restent figés dans une pose solennelle et gardent le silence » (275d). La chose écrite souffre du même défaut. Elle est immuable, écrite une fois pour toutes, elle signifie toujours la même chose, on ne peut ni l'interroger, ni la faire évoluer, elle est muette. Il lui manque la dimension indispensable de la pensée : le dialogue.
— Parce que l'écriture ne se situe pas dans cette dimension du dialogue, elle ne s'adresse à personne : « Chaque discours va rouler de droite et de gauche et passe indifféremment auprès de ceux qui s'y connaissent, comme auprès de ceux dont ce n'est point l'affaire » (275e). L'écriture ne peut produire que des discours impersonnels, des discours passe-partout où en définitive personne ne trouve son compte, à l'inverse de l'enseignement qui s'adresse à chacun en particulier, et qui, comme toute parole digne de ce nom, doit adapter chaque discours à chaque type d'âme.
— Enfin le discours écrit ne peut se passer de la parole, car s'il est mis en cause il ne peut répondre : « Il a toujours besoin de son père, car il n'est capable ni de se défendre ni de se tirer d'affaire tout seul » (275e). Là encore c'est la dimension du débat, de l'échange contradictoire qui manque.
— En définitive, toutes ces critiques peuvent se résumer en une seule : à l'opposé du discours vivant et doté d'une âme, le discours écrit n'a que l'apparence de la pensée. Le seul discours est « celui qui, transmettant un savoir, s'écrit dans l'âme de l'homme qui apprend, celui qui est capable de se défendre tout seul, celui qui sait devant qui il faut parler et devant qui il faut se taire » (276a). C'est la parole vivante seule capable d'enseigner la vérité.
Ainsi celui qui « possède la science du juste et du beau » n'ira-t-il pas la dilapider en la couchant sur le papier. C'est la dialectique et elle seule qui permet l'essor de la pensée. Pour le comprendre, il faut comprendre comment, par le dialogue et le débat, l'homme peut s'élever jusqu'à la connaissance des Idées, le dialogue devenant à la fois l'instrument et l'expression du Vrai. La progression vers la connaissance ne peut se faire que dans le discours échangé, c'est par l'échange rigoureux des questions et des réponses qu'advient le savoir. Apprendre à formuler, à propos de chaque problème, les questions par lesquelles le problème sera posé en termes si corrects que progressivement la bonne réponse ne pourra manquer d'être donnée. Telle est la dialectique. On est au cœur de la philosophie platonicienne : le Logos est manifestation de la vérité.
Si telle est la fonction de la dialectique, c'est pour une double raison : d'abord comme on l'a dit, elle permet un échange fructueux entre deux esprits avides de savoir ; mais, au-delà du dialogue intellectuel, elle repose sur le dialogue entre deux personnes entre lesquelles la proximité affective, l'estime mutuelle, sont le vecteur de la recherche. La seule écriture qui vaille, c'est celle qui s'inscrit dans l'âme, c'est celle « qui parle du juste et de l'injuste, du beau et du bien ». Le discours que celui qui parle porte en lui-même fait naître alors chez celui qui l'écoute un discours de même nature.
Tout autre discours, celui qu'on écrit sur le papier, n'est qu'un jeu stérile, dont l'auteur tire vanité parce qu'il est habile « à le tourner dans tous les sens, à coller des morceaux les uns aux autres et à faire des coupures ». (Qu'aurait dit Socrate s'il avait connu la technique du copier-coller qui tend de plus en plus à se substituer à la réflexion !) Un discours qui est écrit « sans volonté d'instruire, son seul but étant la persuasion, ne mérite pas qu'on s'applique pour l'écrire ou même le prononcer » (277e).
Socrate ne condamne cependant pas totalement l'écriture. On peut lui trouver un avantage dans le fait qu'elle facilite la remémoration. Elle peut aider celui dont la mémoire est défaillante à retrouver ce qu'il sait. Un discours peut être écrit à une triple condition : si l'auteur du discours l'a composé en sachant où se trouve le vrai, s'il est capable de se soumettre à la réfutation, et s'il a conscience du peu d'importance de son discours (celui-ci n'étant en quelque sorte qu'un simple pense-bête) ; alors écrire peut être un moyen de se souvenir et rien ne s'oppose à ce qu'un tel homme soit appelé sinon « sage » du moins « philosophe ».
Fin de l'entretien278b-279c
Tel est le message que Socrate envoie Phèdre porter à Lysias, mais aussi au poète Homère, et au législateur Solon, car les rédacteurs de discours, les rédacteurs de poèmes et les rédacteurs de lois doivent savoir que, si ce qu'ils écrivent est écrit dans l'ignorance complète du juste et de l'injuste, du bien et du mal, ils ne méritent que le blâme, à supposer même qu'ils reçoivent l'éloge unanime de la foule.
Le soir tombe, l'essentiel a été dit, le dialogue s'achève sur une prière aux divinités des lieux, et cette prière formulée par Socrate résume parfaitement l'entretien : « Accordez-moi d'acquérir la beauté intérieure » (279b), la beauté intérieure, c'est-à-dire la seule beauté qui compte, celle de l'âme qui se consacre au juste au vrai et au bien. Et comme Socrate ne se départit jamais de son ironie, il ajoute avec humour : « Et que pour l'extérieur tout soit en accord avec l'intérieur ! »
Le dialogue se conclut sur une injonction : « En route ! » En route vers Athènes bien sûr, mais peut être aussi en route pour ce difficile chemin qui conduit les âmes vers les Idées.
Conclusion
Nous avions posé en introduction la question de l'unité du Phèdre : de l'amour ou de la parole quel est le thème majeur du dialogue ? Cette question ne pouvait trouver de réponse tant que n'apparaissait pas un troisième terme que Socrate a mis au premier plan : celui de dialectique. La parole n'est pas un jeu dans les joutes oratoires que se livrent les beaux parleurs, pas plus qu'elle n'est un instrument de pouvoir dans la bouche des hommes politiques. Elle doit être l'expression du parler vrai, l'indispensable instrument de la marche progressive vers la connaissance. Quand la parole devient dialogue, par le débat, les hommes peuvent s'élever jusqu'à la connaissance des Idées. La progression vers la connaissance ne peut se faire que dans le discours échangé, c'est par l'échange rigoureux des questions et des réponses qu'advient le savoir. On est au cœur de la philosophie platonicienne, le Logos est manifestation de la vérité.
L'unité du Phèdre est alors l'unité de la dialectique. Que l'on parle de l'amour ou que l'on parle du discours, on parle toujours de la même chose : la recherche du monde des Idées. Le délire amoureux comme le discours sont les voies conjointes par lesquelles le prisonnier s'arrache aux ténèbres de la caverne pour tenter d'apercevoir le ciel. C'est pourquoi le véritable amour est dialogue. C'est dans la parole échangée que se concrétise l'amour. Ceux qui aiment, disait Diotime, engendrent de beaux discours. En un premier sens sans doute : comme le disait Agathon, l'amour est poète, l'amour rend poète. C'est-à-dire que l'amour a tendance à se dire, à se chanter, et par là à passer de ce qui est ressenti à ce qui est représenté, et à donner ainsi une dimension humaine à l'amour : dans les mots, l'amour se dit, se raconte, s'invente, s'objective. Mais on peut aller plus loin : le discours que l'amour engendre, ce n'est pas seulement les louanges de l'être aimé ; le discours qui progresse au fur et à mesure de l'ascension, c'est celui que l'amant engendre dans l'esprit de l'aimé, le discours que le savoir accompagne. Si aimer c'est engendrer de beaux discours, engendrer de beaux discours n'est rien d'autre que devenir savant. Le maître amant est celui qui sait faire naître dans l'âme de l'aimé les plus hautes pensées, les discours féconds, les paroles de beauté, par une sorte de fécondation intellectuelle. L'amour est initiation dans et par la parole.
Les thèmes de l'amour et de la parole ne sont donc pas juxtaposés, ils sont les deux faces d'une même réalité : la marche réglée vers le Beau et le Vrai, la dialectique.
|
vendredi 13 septembre 2013
130913 - LECTURE - PLATON - Phèdre
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire